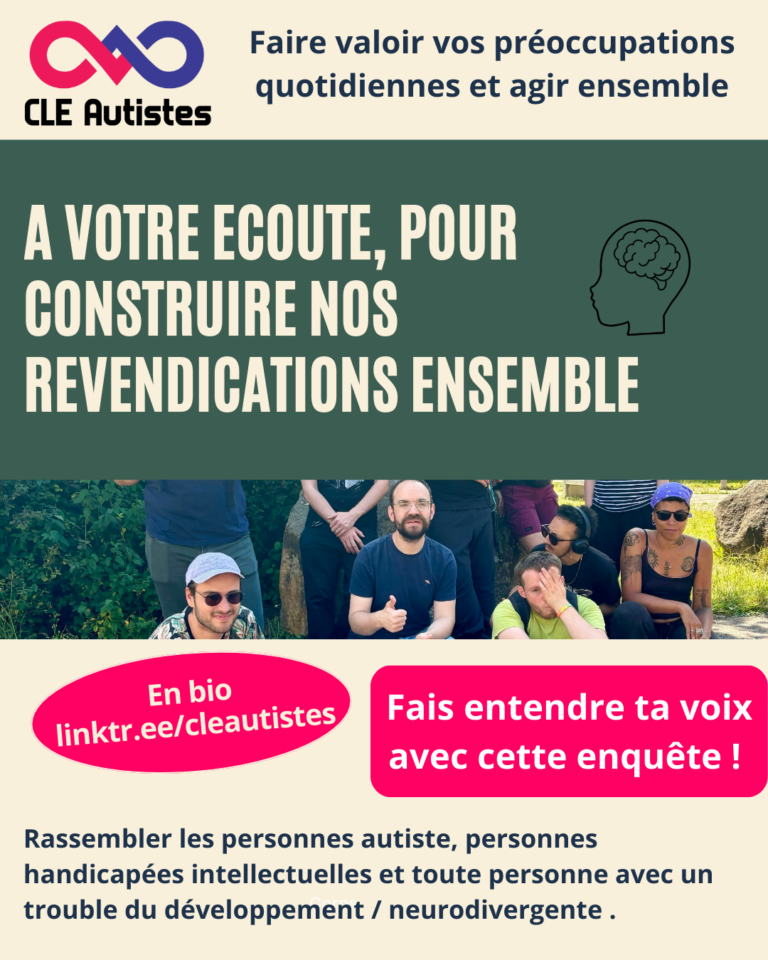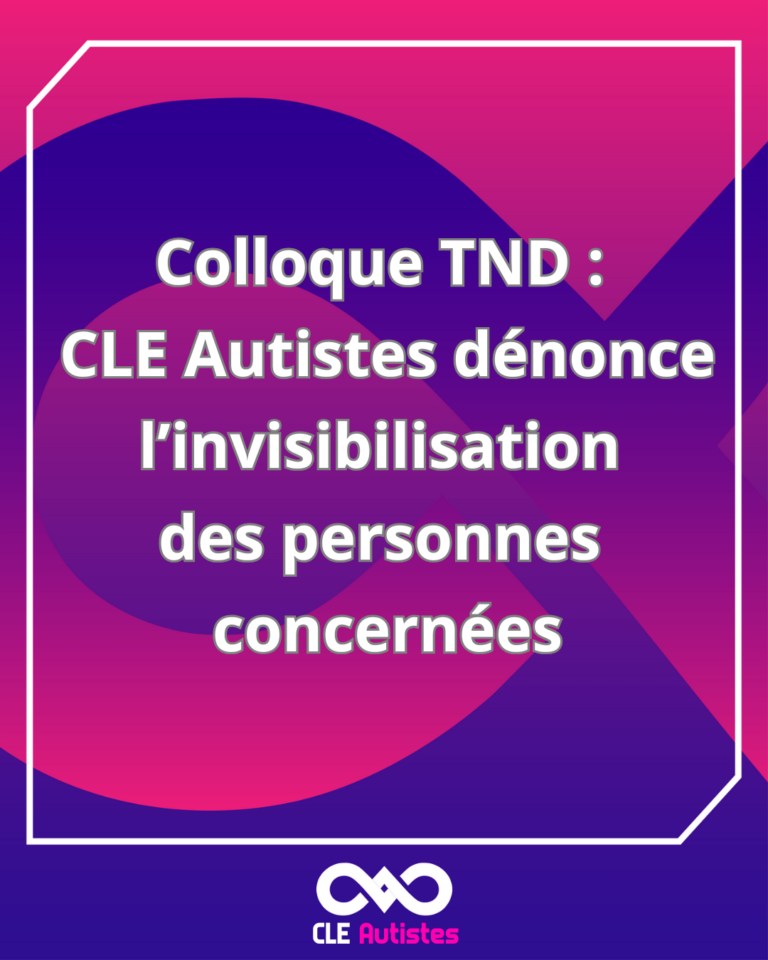Mitzi M. Waltz, PhD, est maître de conférences en études sur l’autisme à l’Autism Centre, Sheffield Hallam University, à Sheffield, au Royaume-Uni, et chercheuse principale pour Disability Studies in Nederland à Amersfoort et à l’Université des sciences appliquées de Rotterdam, aux Pays-Bas. Elle s’intéresse à l’histoire de l’autisme, aux représentations médiatiques et cliniques du handicap et à l’amélioration des conditions de vie des personnes autistes et de leurs familles. Elle est l’autrice de “Autism : a medical and social History”
« Une étude révèle que le coût de l’autisme est supérieur à celui du cancer, des accidents vasculaires cérébraux ou des maladies cardiaques » [1]. C’était l’un des nombreux gros titres annonçant de nouvelles recherches sur le coût, pour les économies britannique et américaine, de la prise en charge à vie des personnes autistes [2].
L’examen par les médias [3, 4] de ces estimations de coûts de 2014 – qui peuvent être trompeuses, car seule une petite minorité de personnes autistes reçoit les services « idéaux » sur lesquels les estimations de coûts sont basées – n’a pas tenu compte du fait qu’elles reposent sur l’hypothèse que les mères d’enfants autistes travaillent moins et achètent de nombreux services, dont beaucoup ne sont pas étayés par des preuves scientifiques et peuvent être plus coûteux que les services dont l’efficacité a été démontrée.
C’est un sujet autour duquel le passé de l’autisme se croise avec son présent. L’attente actuelle d’une prise en charge à plein temps et « professionnelle » des parents d’enfants autistes est enracinée dans un discours de culpabilisation des mères qui s’inscrit dans l’histoire de l’autisme, avant même que ce handicap ne soit nommé et défini.
Cette histoire commence par une panique morale face au comportement des pauvres urbains.
Une nouvelle notion de l’enfance de la classe moyenne, apparue à la fin du XIXe siècle et caractérisée par le chouchoutage, la protection et l’éducation, a suscité des craintes à l’égard des enfants « problématiques » : enfants handicapés ou à faible capacité intellectuelle, enfants des rues et délinquants juvéniles.
Les enfants de ces catégories sont la cible d’un mouvement de sauvetage de l’enfance financé par la bourgeoisie et encadré par la classe moyenne, en particulier par les femmes de la classe moyenne.
Convaincus que la pauvreté, l’immoralité et les comportements “antisociaux” pouvaient être combattus au mieux en remodelant l’enfance, ces « sauveurs d’enfants » ont entrepris une myriade d’initiatives : enseignement obligatoire, maisons d’accueil, tribunaux pour mineurs, écoles de redressement, services sociaux, organisations de protection de l’enfance et centres de recherche axés sur la psychologie, la psychiatrie, le comportement et la criminologie de l’enfant [5, 6].
Les institutions de protection de l’enfance les plus pertinentes pour le traitement ultérieur de l’autisme étaient les centres de recherche sur l’enfance et le mouvement “Child Guidance”, qui cherchait à mettre en pratique les résultats de la recherche. En 1922, le Commonwealth Fund a stimulé la campagne de prévention de la délinquance en finançant des programmes de démonstration dans les cliniques américaines de Child Guidance pour les enfants souffrant de problèmes émotionnels et comportementaux ainsi que pour ceux dont on pensait qu’ils avaient des tendances criminelles, et en généralisant l’utilisation de tests psychologiques et d’intelligence standardisés [7]. Pour la première fois, une population de masse des enfants et des mères a pu être examinée.
Le travail clinique se faisait généralement avec les mères plutôt qu’avec les enfants eux-mêmes.
Par exemple, le sociologue Ernest Groves, qui, avec sa femme Gladys Groves, a été le premier à proposer des conseils matrimoniaux dans les cliniques de Child Guidance, a déclaré que même le maternage typique était pathologique et nécessitait une amélioration scientifique . Les Groves ont suggéré que trop d’affection et trop peu d’attention pouvaient nuire au développement et ont orienté les parents vers des conseils professionnels pour trouver le bon équilibre [8].
Par le biais de livres, d’émissions de radio, de tournées de conférences et d’articles de magazines, des experts comme les Groves, le pédiatre et psychanalyste D.W. Winnicott et, enfin, le psychologue Bruno Bettelheim ont cherché à modifier le comportement des mères afin de prévenir les problèmes sociaux, la criminalité et les handicaps. Selon eux, ce n’est qu’avec des conseils professionnels et une pratique scientifique que les mères peuvent sauver leurs enfants et, par extension, la société. Les pratiques maternelles « correctes » ont été décrites en détail, en commençant par la bonne façon de tenir et de nourrir un nourrisson et en passant par le moment et la fréquence des câlins, des baisers, des gronderies et des fessées.
Les psychologues affirmaient qu’un comportement maternel correct conduirait à des adultes travailleurs, autodisciplinés et respectueux de la loi ; tout écart créerait des adultes faibles d’esprit, mal élevés et aberrants, avec une propension au crime et au radicalisme [9].
Dans ce contexte, sous la direction du psychiatre Adolf Meyer à l’université Johns Hopkins, Leo Kanner a créé en 1930 la première clinique américaine de pédopsychiatrie [10], fortement influencée par les préceptes de la Child Guidance [11]. Meyer a introduit deux principes clés : la primauté de l’étude de cas dans la recherche en pédopsychiatrie et la culpabilisation de la mère. Meyer a écrit que les études de cas qu’il a réalisées avec sa femme, Mary Potter Meyer, « ont contribué à une compréhension sociale plus large de notre problème et ont permis d’atteindre les sources de la maladie, la famille et la communauté », c’est-à-dire les mères [7].
La petite collection d’études de cas de Kanner a défini ce qu’il a appelé « l’autisme » comme un trouble psychiatrique unique apparaissant dès l’enfance. Bien que son premier article, très influent, évoque des causes « innées » possibles [12], ses hypothèses sur la causalité parentale sont claires tout au long de son premier article (les études de cas comprennent de longues descriptions négatives des parents des enfants) et dans de nombreux écrits ultérieurs [13].
Kanner n’était pas non plus le seul à penser ainsi : d’autres théoriciens influents, tels que Margaret Mahler, Melanie Klein et Frances Tustin, ont également identifié les pratiques parentales aberrantes comme étant la cause de l’autisme [9]. La schizophrénie étant elle aussi supposée avoir une cause parentale – la « mère schizophrénogène » [14] – l’emprunt du terme « autisme » aux premiers écrits d’Eugen Bleuler sur la schizophrénie et l’utilisation pendant des décennies de la « schizophrénie infantile » comme synonyme de l’autisme ont encore renforcé ce concept.
Tout comme leur collègue Bruno Bettelheim, aujourd’hui très décrié, qui a popularisé la figure de la « mère réfrigérateur », ces éminents chercheurs avaient tort [15, 16]. Les parents n’avaient qu’à regarder leurs autres enfants, non autistes, pour s’en rendre compte. Mais il est difficile de remettre en question un discours hégémonique, et c’était d’autant plus vrai dans ce contexte que le mouvement Child Guidance avait depuis longtemps popularisé l’idée que les professionnels étaient bien plus compétents et dignes de confiance que les parents ordinaires.
En réaction, cependant, à partir des années 1960, les parents ont créé des groupes de soutien et de pression. L’amélioration de la recherche, souvent sous l’impulsion de parents-chercheurs comme Lorna Wing, a peu à peu fait reculer l’idée que le comportement des mères était à l’origine de l’autisme. L’évolution a néanmoins été lente : en 1983, les chercheurs ressentaient encore le besoin de souligner la faiblesse des preuves établissant un lien entre la pathologie parentale et l’autisme et de réexaminer la littérature à ce sujet [15]. Depuis, les experts sont parvenus à un consensus général sur ce sujet [16]. Mais au lieu de disparaître, la culpabilisation des mères a adopté des formes plus discrètes.
Les méthodes comportementales de traitement de l’autisme, popularisées pour la première fois dans les années 1970 par Ivar Lovaas, reposaient également sur la culpabilisation de la mère.
De nombreux comportementalistes radicaux considéraient les nourrissons comme une « ardoise vierge » sur laquelle le comportement était imprimé par les interactions entre le nourrisson et ses parents [17]. La thérapie ABA (applied behavior analysis) de Lovaas présentait des méthodes pour enseigner l’obéissance absolue aux demandes des adultes et la conformité comportementale comme un « traitement » de l’autisme, dont l’objectif déclaré était de rendre les enfants autistes « indiscernables de leurs pairs » [18].
Cet objectif devait être atteint grâce à des exercices répétitifs pouvant aller jusqu’à 40 heures par semaine, généralement effectués par des mères travaillant en tête-à-tête avec leur enfant sous la supervision d’un professionnel. L’ABA est toujours considérée comme une approche courante, malgré des préoccupations éthiques, des coûts élevés et des résultats inégaux [19].
Une telle intensité exige que les mères soient engagées dans une « parentalité thérapeutique » presque à chaque instant. Il ne s’agit là que d’une itération plus subtile de la mentalité de sauvetage de l’enfant qui fait porter aux mères la responsabilité de l’autisme, par le biais de la responsabilité de la prévention ou de l’amélioration de la situation.
La « mère autiste » d’aujourd’hui n’est plus la « mère réfrigérante » abjecte, elle est censée être une héroïne qui sauve l’enfant, censée et encouragée à faire tout et n’importe quoi à la recherche de la normalité, des régimes spéciaux aux écoles spéciales, des médicaments aux jouets thérapeutiques.
Cependant, le discours reste celui d’une culpabilité parentale dissimulée : si votre enfant devient un adulte autiste, c’est votre faute parce que vous n’avez pas fait assez pour le sauver.
La mère autiste doit se positionner en héroïne, localiser et attaquer sans relâche la menace des symptômes autistiques en achetant les bonnes thérapies, en évitant les « toxines » dans l’alimentation, l’environnement et les médicaments, et en acceptant que le comportement autistique est mauvais et doit être contré par des médicaments psychiatriques ou des actions directes. Bien que cela soit fatigant, coûteux et frustrant, de nombreux parents se sentent poussés à jouer ce rôle : ce sont les parents qui ont fondé et financé la plupart des premières écoles et des premiers programmes de thérapie spécifiques à l’autisme dans les années 1960 et 1970 [20] ; ce sont également en grande partie les parents qui ont mené la récente croisade contre les vaccinations, axée sur l’autisme.
Cette pression sociale pour sauver son enfant, associée aux changements socio-économiques de l’État néolibéral, dans lequel les services publics ne sont plus financés et de moins en moins disponibles, a donné lieu à une commercialisation directe du foyer familial médicalisé. Les thérapies les plus dangereuses et les plus fausses, des injections de Lupron aux lavements à l’eau de Javel, ont été promulguées par le biais d’appels directs aux mères. Le souvenir de la culpabilisation directe des mères persiste et se traduit par une méfiance à l’égard des experts médicaux et éducatifs traditionnels. L’État attend des parents qu’ils jouent le rôle de coordinateurs de traitement et les autres parents les valorisent en prenant les mesures les plus visibles, les plus coûteuses et les plus extrêmes, comme si, ce faisant, ils pouvaient éviter d’être blâmés.
Depuis les années 1960, ceux qui vendent des interventions pour l’autisme ont utilisé les parents comme agents de marketing et parfois comme boucliers contre les critiques. Par exemple, le médicament Secretin, aujourd’hui discrédité, a été commercialisé par le biais de témoignages de parents, d’abord sur des listes de diffusion Internet, puis à la télévision nationale [21] ; aujourd’hui, des cliniques de cellules souches douteuses s’appuient régulièrement sur des « témoignages de parents » sur des listes de diffusion ou des sites de réseautage social pour attirer des clients [22].
En France, où les explications psychologiques continuent de prévaloir, les groupes de défense des parents sont devenus les agents de marketing des thérapies « modernes » telles que l’ABA, qui semblent rejeter la responsabilité sur les parents [23]. Les parents ont été mobilisés pour défendre l’indéfendable, y compris les programmes abusifs – par exemple, en étant encouragés à écrire des lettres aux journaux et aux juges pour faire l’éloge d’établissements où des enfants autistes ont subi des violences ou pour que leurs histoires soient diffusées comme couverture pour des praticiens discrédités tels qu’Andrew Wakefield [9].
Et pourtant, malgré les efforts intenses des parents, les enfants autistes continuent de devenir des adultes autistes. Les services dont la recherche a montré qu’ils avaient un impact mesurable sur les résultats sont peu nombreux, même si l’éducation spécialisée, qui n’était pas disponible avant les années 1970, peut être utile [24].
Le coût de la culpabilisation continue des mères est élevé, et pas seulement sur le plan financier. L’encouragement à l’héroïsme peut causer des dommages physiques directs aux personnes autistes. Des dommages psychologiques peuvent également survenir, à la fois pour les parents injustement culpabilisés et pour les personnes autistes, qui reçoivent le message qu’elles sont « malades » ou même, puisque certaines thérapies extrêmes comportent des risques mortels, que l’autisme est un destin pire que la mort.
L’accent extrême mis sur la sauvegarde de l’enfant contribue également à un manque de services pour les adultes autistes : si vous pensez que votre enfant peut et doit être guéri, cela devient l’objectif plutôt que de lutter pour l’inclusion, les services et le soutien en partenariat avec les adultes handicapés. Dans l’intérêt des personnes autistes et de leurs familles, nous devons faire mieux.
Source : https://journalofethics.ama-assn.org/article/mothers-and-autism-evolution-discourse-blame/2015-04
article publié dans American Medical Association Journal of Ethics, 17(4): pp. 353-358 :
Traduction de l’anglais. Si vous avez des suggestions d’amélioration. Merci de nous contacter.
Description de l’image : enfant autiste derrière un miroir, le miroir donne un effet flouté.
Crédit image : Tramper / Shutterstock