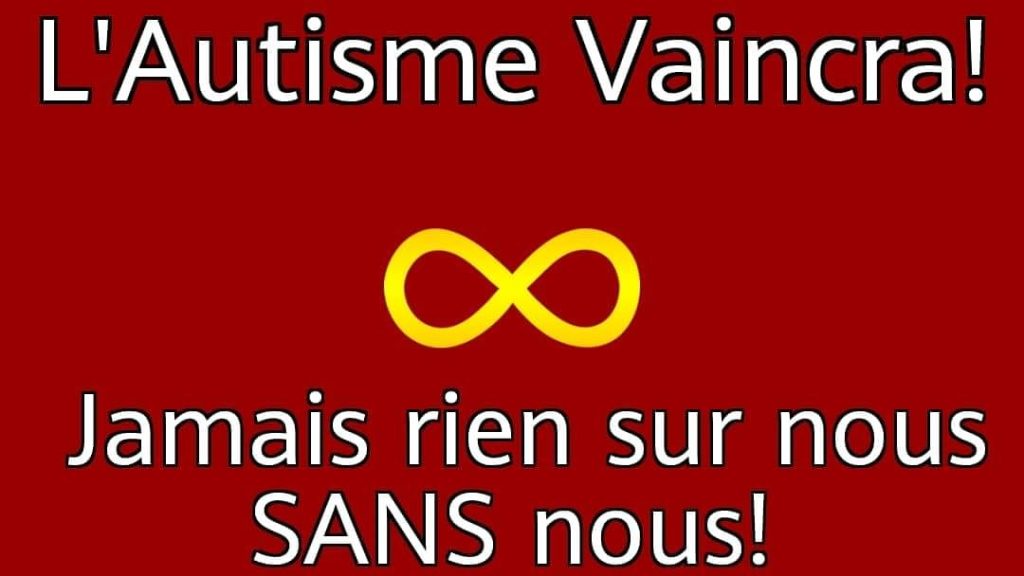
L’ABCD de la neurodiversité
L’émergence de la culture autiste et neurodivergente a conduit à la création de définitions appropriées pour décrire un groupe social marginalisé, comme la plupart des nouveaux courants de pensée et d’autres mouvements marginalisés. Le mouvement de la neurodiversité se construit également de façon intersectionnelle et prend en compte toutes les réflexions militantes sur différents sujets.
Toute la mobilisation concernant le mouvement d’autodéfense autistique avec l’Autism International Network (ANI) constituait un terreau pour la création de la philosophie de la neurodiversité.
Alliste
Pour faire référence aux non-autistes en 2003, le concept «d’alliste en anglais» est apparu dans un article satirique d’Andrew Main, dans lequel être «non-autiste» est décrit comme une «condition peu connue». Alliste vient du grec “allos” qui signifie l’autre et du suffixe “ismus” qui signifie condition de, c’est-à-dire condition d’être centré sur l’extérieur. Contrairement à l’autisme qui serait centré sur l’intérieur. Il permet aux autistes de ne pas s’approprier le terme neurodivergence qui peut concerner des personnes non-autistes (avec des conditions psychiques ou autres conditions neurologiques).
Autiste
Une personne autiste est une personne qui peut ou non s’identifier comme handicapée et dont le handicap et l’identité sociopolitique sont liés à la manière dont elle s’engage avec le monde qui l’entoure. Les personnes autistes vivent et s’engagent dans le monde différemment de la société neuronormative sur les plans sensoriel, du traitement et de la réponse aux informations.
Complexe Médico-Industriel
Terme inventé par Mia Mingus, militante pour la justice handie. Le complexe médico-industriel est un énorme système dont les tentacules s’étendent au-delà des médecins, des infirmières, des cliniques et des hôpitaux. Il s’agit d’un système axé sur le profit, avant tout, plutôt que sur la “santé”, le bien-être et les soins.
Par exemple, le complexe industriel de l’autisme concerne toute l’industrie autour de l’autisme (thérapies, méthodes alternatives, interventions, services éducatifs, foyers, tests diagnostics). Il y a aussi le complexe industriel de santé mentale qui englobe la psychiatrie et ses ramifications.
Fol
Neutre de fou/folle.Terme historiquement utilisé pour opprimer les personnes qui souffrent de détresse émotionnelle et d’états d’âme non normatifs ou non conventionnels. Le terme “fol” a été récupéré en tant qu’identité sociopolitique pour les personnes qui souffrent de détresse émotionnelle et/ou qui ont été étiquetées comme “malades mentaux” ou comme ayant des “problèmes de santé mentale”. Un individu fol est une personne dont l’identité et la personnalité sont contraires aux conventions sociales, qui subvertit, défie, perturbe et se libère de ce qui est considéré comme “sain d’esprit”. Être fol, c’est être fier des états mentaux qui ont été jugés criminels et déficitaires.
Intériorisation
Les systèmes d’oppressions systémiques (validisme, neurotypicat, patriarcat, racisme, hétéronormativité) ancrent inconsciemment des constructions culturelles et sociales dans les esprits. Les personnes concernées et dominées peuvent intégrer des croyances oppressives (validistes, psychophobes, racistes etc). Même les militant.es sont touchées par cette intériorisation et peuvent parfois reproduire ces croyances. Nous sommes tout simplement éduqué.e.s dans ce système et toute personne concernée peut être oppressive. Cela conduit à se détester, à se flageller, à croire aux préjugés sur soi etc… L’estime de soi s’en trouve affectée. Une phase de déconstruction est nécessaire pour réfléchir sur ces croyances intériorisées.
Intersectionnalité :
Le concept d’intersectionnalité a été créé par Kimberle Crenshaw, juriste noire, pour des raisons juridiques. Les femmes noires aux Etats-Unis en effet ne pouvait pas se défendre contre les discriminations car il fallait trouver une raison unique contre elles. Si c’était parce qu’elles étaient noires, on leur disait que les hommes noirs ne subissaient pas la même discrimination, si c’était pour leur genre, on disait que les femmes blanches ne le subissaient pas non plus. Elles étaient déboutées systématiquement. Ce concept permet donc d’étudier les croisements entre différentes discriminations et de travailler sur les interactions de différentes oppressions systémiques : être une femme noire, être une femme transgenre noire en situation de handicap etc. En savoir plus
Les larmes (tears)
Lorsqu’une personne privilégiée et dominante ramène la conversation à ses propres émotions voire se place en position de victime face à la personne opprimée. Il y a recentrage de la personne non-concernée dans le discours en se victimisant (moi moi moi). Larmes de valides, de mecs, de neurotypiques etc…
Neurodivers / Différent
“Beaucoup de gens utilisent à tort neurodivers ou neurodivers lorsque le mot correct est neurodivergent
Chaque individu-e est différent-e, sans que cela ne pose problème en soi. La divergence opère par rapport à une norme de groupe (Walker, 2014). Cela est intrinsèque à la signification et à l’utilisation appropriée du terme divers .
Lorsque le neurodivers est utilisé pour désigner des personnes qui diffèrent de la neuronorme, philosophiquement cela implique de dire que les personnes qui ne font pas partie de la neuronormativité sont diverses, mais que les personnes qui dominent la neuronormativité ne font pas partie de la diversité humaine, la diversité n’est donc que pour les minorités et le sens du concept est dilué.
Si nous utilisons le neurodivers pour désigner des personnes qui s’écartent de la norme au niveau conceptuel, nous mettons les personnes neurotypiques au-dessus (qui ne sont pas différentes de cette approche). Pour tout cela, il vaut mieux parler de neurodivergent plutôt que de neurodivers . Neurodivergent se réfère au fait qu’on opère d’une manière qui diverge de la norme sociale. Si nous appelons quelqu’un un neurodivergent, nous soulignons une différence structurelle et matérielle.
Utiliser au niveau politique “neurodivers ” n’a pas de sens car au niveau conceptuel, dans la réalité (et non celui qui est mal utilisé par les réseaux sociaux), il dit simplement qu’il existe une diversité infinie. Ce concept ne sert à rien pour travailler sur les oppressions systémiques et structurelles, car dans la réalité tout le monde est neurodivers. Bien que tous les individus soient des neurodivers, nous devrons travailler sur les inégalités dont souffrent les neurodivergents et sortir de la neuronormativité sociale.
Neurodiversité
La neurodiversité est l’idée que tous les cerveaux et les esprits sont différents dans leur fonctionnement – il n’y a pas deux cerveaux ou systèmes nerveux identiques.
A l’origine les communautés autistes en ligne (ANI et INLV aux Pays-Bas) ont fait émerger le terme de “diversité” ou de “pluralité” neurologique à l’automne 1996. Le terme neurodiversité a été proposé au niveau académique par Judy Singer, une sociologue australienne du spectre autistique, suite à son observation de ces communautés pour son mémoire de Master. Ce concept est apparu pour la première fois dans un article publié par le journaliste Harvey Blume (qui n’a pas crédité Singer) dans The Atlantic, le 30 septembre 1998 (Silberman, 2015):
Cependant, dans un article paru dans le New York Times du 30 juin 1997, Blume n’utilisait pas le terme “neurodiversité”, mais décrivait une idée semblable avec le “pluralisme neurologique” (Silberman, 2015):
“La neurodiversité peut être aussi cruciale pour le genre humain que la biodiversité pour la vie en général. Qui peut dire quel type de câblage neuronal fonctionnera le mieux à l’avenir? L’informatique et la culture informatique, par exemple, peuvent favoriser les autistes “(Blume, 1998).
Cependant, lorsqu’ils essaient de parvenir à un accord dans un monde dominé par les NT, les personnes autistes ne veulent pas et ne peuvent pas non plus renoncer à leurs propres coutumes. Au lieu de cela, ils proposent un nouveau pacte social basé sur le pluralisme neurologique. Le consensus qui se dégage des forums Internet et des sites Web où les personnes autistes se rencontrent est que le NT n’est qu’une des nombreuses configurations neurologiques, celle qui est sans doute dominante, mais pas nécessairement la meilleure.
Blume, 1997.
Par la suite, en 2014, la militante autiste et folle Nick Walker a donné la définition suivante qui est actuellement utilisée dans la neurodiversité:
La neurodiversité est la diversité des cerveaux et des esprits humains, la variation infinie du fonctionnement neurocognitif au sein de notre espèce. La neurodiversité est un fait biologique. Ce n’est pas une perspective, une approche, une conviction, une position politique ou un paradigme. C’est le paradigme de la neurodiversité (voir ci-dessous), pas la neurodiversité elle-même. La neurodiversité n’est pas un mouvement politique ou social. C’est le mouvement de la neurodiversité, pas la neurodiversité elle-même. La neurodiversité n’est pas un trait qu’un individu possède. La diversité est un trait de caractère appartenant à un groupe et non à un individu. Lorsqu’un individu diverge des normes dominantes dans la société du fonctionnement neurocognitif “normal”, il ne “possède pas de neurodiversité”, il est neurodivergent.
Nick Walker (2014).
En outre, Walker définirait le mouvement de la neurodiversité comme:un mouvement de justice sociale qui recherche les droits civiques, l’égalité, le respect et l’inclusion sociale complète des neurodivergents (Walker, 2014).
Neurodivergent / Neurodivergence
Le concept de neurodivergent a été inventé par Kassiane Asasumasu, une militante plurineurodivergente. Nick Walker le définirait comme suit:
Neurodivergent, parfois abrégé en ND, signifie avoir un cerveau qui fonctionne de manière très différente des normes sociales en vigueur. ce terme désigne le fait que le cerveau d’une personne traite, apprend et/ou se comporte différemment de ce qui est considéré comme “typique”.
Le paradigme de la neurodiversité rejette la pathologisation de telles formes de neurodivergence et le mouvement de la neurodiversité s’oppose aux tentatives de les éliminer.
Neuronormativité
La neuronormativité est l’ensemble des normes sociales, politiques, culturelles et personnelles qui privilégient une certaine façon de penser et de communiquer comme étant supérieure à d’autres.
Neurotype
Comme indiqué précédemment, le mouvement de la neurodiversité met l’accent sur l’idée qu’il existe de nombreuses variantes du câblage humain dans le cerveau. C’est dans cette diversité de neurologies que le terme “neurodiversité” prend son origine. Un neurotype est le nom donné à une forme individuelle de câblage . Le neurotype dit “normal” est appelé neurotypique (NT) et est ce que l’on pense de la société de plus en plus commun ou “typique”, d’où son nom.
La société en général, et en particulier les professionnels de la santé, considère souvent le NT comme le type de fonctionnement cérébral sain le plus souhaitable et peut-être le seul. Le mouvement de la neurodiversité cherche à changer cette hypothèse. D’après ce paradigme, il est proposé qu’il existe de nombreux neurotypes différents, peut-être si nombreux que les soi-disant NT sont en réalité une minorité.
Chaque neurotype est un type de cerveau, avec des avantages et des difficultés propres en termes de santé, de capacité, de fonction, etc.
La société est organisée en fonction des capacités attendues par la norme neurotypique (Wikiversity, 2018). L’ origine historique de ce concept n’a pas été trouvée.
Neurotypique (NT abrégé)
De ANI, le concept de «neurotypical» a été créé (Silberman, 2016), qui a été défini comme suit:
Neurotypique peut être utilisé soit comme adjectif (“il est neurotypique” et “elle est neurotypique”), soit comme nom (“il est neurotypique” et “elle est neurotypique”). Ce terme désigne les personnes qui se conforment à des standards touchant à la manière dont une personne serait sensée être capable de conduire son corps, de s’exprimer verbalement, d’intérargir socialement et de ressentir les choses, que ce soit au niveau sensoriel et/ovu émotionnel.
Le neurotype dit “normal” est appelé neurotypique (NT). Les personnes (dites) neurotypiques ont un style de fonctionnement cérébral qui s’inscrit dans les normes sociales dominantes pensées comme “normales“.
Avec cette définition, les personnes ayant un TDAH (par exemple) ne seraient plus des personnes neurotypiques (Walker, 2014).
Neuroqueerité
Un individu neuroqueer est un individu dont l’identité, la personnalité, la performance de genre et/ou le style neurocognitif sont contraires aux conventions. Le neuroqueering est la pratique qui consiste à subvertir, défier, perturber et se libérer simultanément de la neuronormativité et de la cis-hétéronormativité.
Neurotypicalité
Système culturel, social, juridique et historique fondé sur une neuronormativité dominante avec la détention du pouvoir par les personnes neurotypiques. Ce pouvoir permet de renforcer le capitalisme, qui cherche à extraire la force de travail cognitive la plus rentable et la plus optimale possible. Il s’appuie sur la médecine, la psychiatrie et le complexe médico-industriel pour rééduquer et conformer les personnes à la neuronormativité.
Normal
NT est considéré comme plus spécifique que “normal”, car la définition de “normal” dépend dans une large mesure du contexte.
Cependant, les membres de la communauté ANI sont bien conscients que, dans le contexte des êtres humains en général, nous ne sommes pas normaux. Reconnaître ce fait n’est pas considéré comme insensible ou péjoratif. La plupart d’entre nous ne craignent pas de ne pas être normaux et ne voulons pas être normaux. Nous apprécions être reconnus pour ce que nous sommes! (Sinclair, 1998).
Neurocapacitisme
Système d’oppression structurelle (matérielle et symbolique) qui légitime et produit la violence (physique, médicale, psychologique, éducative, économique, sociale…) contre les personnes ayant une condition mentale divergente, à partir de l’imposition d’un neurotype défini selon le paradigme médical et colonial dominant.
Oppression Systémique
Ou Oppression structurelle. C’est tout simplement le fait que le système politique, socio-économique et social qui organise notre vie en société produit et renforce des inégalités et des discriminations subies par une partie de la population. Une partie dite “dominante” de la population bénéficie de privilèges car les membres la constituant partagent une caractéristique considérée comme étant supérieure et/ou la norme (hétérosexualité, blanchité, neurotypicité, validité etc). En savoir plus
#PasToutes (#NotAll)
C’est la phrase des personnes privilégiées et dominantes qui affirment que toutes les personnes dominantes ne sont pas oppressives. Or il est évident qu’il y a des personnes privilégiées mieux éduquées que les autres et que tous et toutes les privilégié.es ont internalisé des mécanismes oppressifs. C’est une tactique pour détourner la conversation du réel problème.
Police du ton (tone policing)
Tactique qui permet de réduire au silence les personnes marginalisées et dominées en critiquant l’émotion (colère, agressivité, haine, virulence) et la forme présente dans leur discours, alors que l’émotion fait partie intégrante de l’oppression vécue. Les personnes dominantes disent souvent qu’elles refusent d’écouter si les personnes opprimées ne se “calment” pas (injonction au calme).
Psychophobie / Sanisme :
Système politique de domination, d’exploitation et d’exclusion des personnes, croyances et façons de vivre déclarées irrationnelles, inconnaissables et non quantifiables conduisant à l’oppression des fols / psychiatrisé-e-s. La psychophobie est une oppression systémique qui considère que les fols sont dangereux ou irresponsables alors que les études statistiques ne montrent pas de différences avec la population globale. Cette oppression engendre des violences institutionnelles telles que l’internement forcé, la mise sous tutelle, la contention ou l’isolement.
Les personnes autistes sont encore psychiatrisées pour certains de leurs comportements et peuvent être considérés comme dangereuses ou violentes. La psychophobie à l’inverse renforce la stigmatisation dans l’accès aux soins et dans l’usage des services de santé mentale pour les personnes neurodivergentes et fols. En savoir plus
‘Spliquer (‘Splaining)
C’est quand une personne non-concernée par les oppressions systémiques (personne neurotypique, valide etc…) explique aux marginalisées leur vie concernant cette oppression (comment mener leur combat, ce qu’ils et elles devraient ressentir). On forme les termes validospliquer, mecspliquer etc à partir de ce suffixe…
Validisme
Système politique de domination, d’exploitation et d’exclusion des corps et des esprits qui ne correspondent pas aux normes physiques, d’intelligence, de productivité, d’adaptation ou de désirabilité.
Ce système engendre un statut social inférieur pour les personnes handicapées. Le validisme est une oppression systémique qui produit et légitime les violences et les discriminations à l’encontre des personnes ayant un handicap visible ou non. Elles ont moins d’opportunités que les personnes valides, les besoins et leurs droits sont restreints par un manque d’accessibilité et de soutien.
L’institutionnalisation est la forme institutionnelle du validisme car il construit et maintient une barrière de nature (biologique) entre personnes valides et non valides, elle fait du handicap une justification politique des discriminations et inégalités sociales touchant les personnes handicapées. En savoir plus – Chiffres
