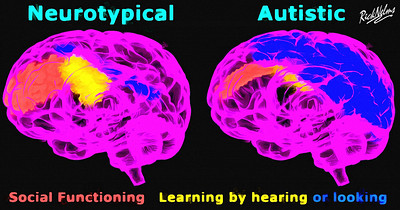Discours de Emilia Turc donné le 1er juillet 2025 à la session parité et égalité des chances au congrès général 2025 de la société française de physique.
Afin d’accéder à l’endroit-même où je prononce ce discours, une simple estrade dans un amphithéâtre universitaire, j’ai dû franchir quelques marches, sans rampe. Il y a deux ans, alors que je me déplaçais en fauteuil roulant au quotidien, cela m’aurait été impossible. Ce qui peut sembler un détail logistique incarne pour moi une métaphore d’exclusion : celle d’un système qui n’imagine même pas des personnes handicapées en position d’enseigner ou de présenter leurs travaux. Tout comme ces marches font partie de l’architecture de ce bâtiment, l’inaccessibilité est enracinée dans la construction de l’université. Trop souvent, la responsabilité de la mise en place d’aménagements repose sur les individus handicapés. On attend des personnes handicapées qu’elles compensent, qu’elles anticipent, qu’elles négocient leurs droits — au lieu de repenser un environnement accessible par conception.
Ce système-là, c’est le validisme. Un système politique de domination, d’exploitation et d’exclusion des corps et des esprits qui ne correspondent pas aux normes physiques, d’intelligence, de productivité, d’adaptation ou de désirabilité. Il engendre un statut social inférieur pour les personnes handicapées, et produit et légitime les violences et les discriminations à leur encontre.
Aujourd’hui, je vais certes témoigner des violences validistes que j’ai subies dans mon parcours académique. Mais avant tout, je veux montrer que ce parcours personnel révèle que le validisme est structurel au monde académique, et qu’un effort collectif d’accessibilité implique de remettre en question l’arbitraire des normes de productivité et de sélection qui le fondent.
Dans cette optique, je propose ici une lecture du validisme académique à travers le prisme des disability studies, un champ interdisciplinaire — mêlant sociologie, philosophie, histoire, sciences politiques, et études littéraires — qui analyse le handicap comme une construction sociale, politique et culturelle. En mobilisant ces outils, j’invite à réfléchir au-delà des seuls aménagements individuels, pour penser collectivement une transformation des normes mêmes qui structurent la recherche scientifique.
Mon parcours : l’injonction à la conformité et la violence de la compensation
Pour comprendre comment le validisme traverse l’institution académique, j’aimerais partir de mon propre parcours, un parcours que beaucoup qualifieraient d’« exemplaire ». J’ai suivi des classes préparatoires maths / physique dans un des meilleurs lycées de France, avant d’être admise à l’Ecole polytechnique, où je me suis spécialisée en mathématiques appliquées, tout en suivant une licence de philosophie en parallèle. J’ai poursuivi mes études avec un master en apprentissage machine, et je suis aujourd’hui en thèse de mathématiques appliquées, où je modélise les dynamiques du cerveau sous anesthésie générale.
Mais ce parcours n’a été rendu possible qu’au prix d’une répression constante de mes besoins réels, d’un effort continu de conformité, d’une négligence de ma santé, et de la dégradation de celle-ci.
Je suis handicapée.
Physiquement, à cause d’une maladie chronique douloureuse et fluctuante.
Et cognitivement, car je suis autiste, fait qui a longtemps été ignoré, jamais détecté dans ces milieux si élitistes.
Mon handicap a souvent été invisible, mais l’était-il réellement ? Ou s’agissait-il plutôt d’une souffrance invisibilisée ?
J’ai appris à cacher, minimiser, surcompenser. À me forcer à courir pour les épreuves d’admission à l’Ecole polytechnique, malgré la douleur. À mentir par omission lors des visites médicales. À faire bonne figure face à des institutions qui, pour m’autoriser à passer le concours, exigeaient que je prouve être “apte à la vie en communauté”. Une formulation glaçante, quand on sait ce qu’elle implique pour les personnes neuroatypiques.
Cette stratégie d’adaptation n’est pas une victoire. Elle a eu un coût. L’entrée dans cette école a marqué un point de bascule : mes symptômes se sont aggravés. J’ai dû passer deux ans en fauteuil roulant, avec une longue hospitalisation. L’environnement sensoriel et social épuisant et imposé d’une grande école d’ingénieur a exacerbé mes difficultés cognitives et m’a menée au burnout autistique. C’est seulement à ce moment-là qu’un diagnostic d’autisme a été posé.
Toutefois, même une fois la reconnaissance de handicap formalisée administrativement et dévoilée, mon parcours académique n’a pas été de tout repos.
Mon handicap est une double peine :
Vivre avec les symptômes de ma maladie au quotidien, les douleurs et la fatigue, la charge mentale des traitements, et devoir en plus me justifier et me battre constamment pour mes droits auprès des administrations et des individus.
Ces violences systémiques ont des répercussions sur ma santé mentale: je porte en moi la culpabilité de ne pas avoir le même rythme que les autres chercheurs, de parfois ne pas pouvoir travailler à cause des symptômes, la sensation d’être une “anomalie” dans ce système élitiste, et la conviction que quelqu’un de valide ferait mieux que moi — et donc que je dois toujours en faire plus pour mériter ma place et justifier mon inclusion.
Un univers académique validiste par construction
Mon témoignage met donc en lumière un univers académique validiste par construction. Alors que la recherche scientifique se présente comme un espace neutre, objectif, rigoureux, dans les faits, il s’agit d’une tour d’ivoire élitiste et profondément validiste, fondée sur une hiérarchie implicite des corps et des esprits.
Dans Academic Ableism, Jay Dolmage analyse comment la structure académique elle-même produit de l’exclusion, tout en la dissimulant derrière les notions de rigueur, d’excellence, et de professionnalisme. On n’y accède pas seulement par le savoir : il faut répondre à des critères implicites excluant par essence les personnes handicapées. L’idéal du chercheur est hypermobile, ultra-productif, toujours présent, dans tous les sens du terme. Un chercheur sans limites, sans fatigue, sans besoin d’aide. Et surtout : un chercheur transparent émotionnellement, rationnel, rapide, cohérent.
Selon Margaret Price dans Mad at School, les formes de cognition valorisées dans l’enseignement supérieur excluent les personnes dites “folles”, avec des handicaps psychiques ou cognitifs. En effet, le discours académique attend de nous de la rationalité émotionnelle normée, de la rapidité, et une réflexion linéaire et compréhensible sans efforts – des attributs allant à l’encontre du fonctionnement de nombreuses personnes neuroatypiques.
L’espace informel des réseaux académiques est tout aussi problématique : il suppose des codes sociaux implicites et une aisance dans les interactions, sans structure, que beaucoup de personnes autistes n’ont pas.
Et surtout : ce système valorise l’indépendance à outrance.
L’idée de faire appel à une aide humaine pour mener à bien des expériences reste honteuse — alors même que la science se construit dans la collaboration et l’interdépendance.
Ainsi, de nombreuses demandes d’aménagement telles que les deadlines prolongées, l’aide humaine, le besoin d’instructions claires, écrites et explicites, vont à contre-courant d’un système fondé sur la standardisation et l’efficacité. Pourtant, dans de nombreux cas, il suffirait d’un accompagnement sur des tâches perçues comme « basiques » — selon une norme arbitraire — pour révéler les compétences, l’intelligence et le potentiel d’une personne jusqu’ici entravée. Mais notre imaginaire collectif associe incapacité ponctuelle à incapacité totale, et autonomie à valeur scientifique, niant ainsi l’existence même des talents et des contributions des personnes handicapées.
De ce fait, les personnes handicapées sont poussées à décrocher de leurs études, à compenser leurs difficultés par leurs propres moyens, ou à dévoiler leur handicap dans un environnement qui leur est hostile. Dans Negotiating Disability, Kerschbaum et ses collègues montrent que divulguer son handicap dans l’univers académique, c’est entrer dans un processus de négociation continue : de son identité, de sa crédibilité, de son droit d’être là. Le combat ne s’arrête donc pas après une reconnaissance de handicap, ou après la mise en place d’aménagements, surtout que ceux-ci ne sont pas toujours respectés ou suffisants.
La souffrance des personnes handicapées comme symptôme d’un système en crise
En réalité, la souffrance des personnes handicapées dans le monde académique n’est pas spécifique au handicap – elle révèle les dysfonctionnements d’un système reposant sur la productivité néolibérale.
Les auteurs de Ableism in Academia, édité par le UCL press, parlent d’un régime de l’efficacité, imposant l’excellence comme quantité de production, la course aux financements et la culture du publish or perish.
En effet, ces dernières décennies, l’enseignement supérieur a entamé un processus de markétisation et de bureaucratisation. La baisse des financements publics pousse les chercheurs à faire appel à d’autres sources de financements. Avec la mondialisation, les universités se transforment en entreprises, réorientant leurs objectifs pour répondre à une logique consumériste : satisfaire les attentes des étudiants, améliorer le rapport qualité-prix, renforcer l’employabilité et atteindre des résultats mesurables. Pour cela, des critères de qualité sont introduits, accentuant la pression sur les enseignants et les chercheurs. L’objectif devient alors de renforcer le prestige et l’attractivité de l’université pour attirer financements et étudiants.
La prémisse d’un tel régime rigide de productivité est un être standard, normatif, pleinement capable et apte. En bref, le validisme dans le monde universitaire est endémique.
Dans ce système, même les personnes valides finissent par souffrir. Le modèle social du handicap définit celui-ci non pas comme une déficience individuelle, mais comme le résultat d’un environnement inadapté. Autrement dit, une personne est « handicapée » non à cause de ses limitations physiques, sensorielles ou cognitives, mais parce que la société échoue à prendre en compte la diversité des corps et des esprits dans ses structures, ses normes et ses pratiques. A travers ce prisme, l’université néolibérale crée elle-même des handicaps en imposant des normes de fonctionnement qui excluent ou épuisent, et générant burn-out, anxiété, isolement, ou douleurs chroniques liées à la sédentarité. Le modèle social nous aide à voir que ces souffrances ne sont pas des faiblesses individuelles, mais les symptômes d’un système inadapté, qui pathologise toute forme de différence.
Changer les normes : l’accessibilité comme transformation systémique
Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler une chose trop souvent tue : les chercheurs handicapés existent. On existe. Le handicap est présent dans la société, il concerne donc aussi le domaine de la recherche.
Alors, que faire ?
Il ne suffit pas d’inclure les personnes handicapées dans un système pensé sans elles.
Il faut transformer ce système.
L’accessibilité n’est pas une rampe ajoutée à la fin, ni des aménagements accordés à titre dérogatoire. C’est un changement de paradigme.
Comme le propose Dolmage dans Academic Ableism, il faut s’inspirer des principes du Universal Design for Learning : penser dès le départ des espaces, des enseignements, des processus accessibles — et non aménagés a posteriori. Une telle accessibilité bénéficie à toutes et tous : aux personnes âgées, enceintes, en dépression ou malades.
Agir pour l’accessibilité, c’est donc :
- Repenser les espaces et formats de travail
- Légitimer des rythmes non linéaires,
- Reconnaître la pluralité des cognitions et des corps,
- Interroger ce que nous appelons “professionnalisme”,
- Et surtout : ne pas voir la personne handicapée comme une anomalie. A la place, apprenons à voir ce qui, dans l’environnement, produit l’exclusion et la présente comme naturelle.
Conclusion
En conclusion, l’inclusion ne devrait pas être une case à cocher dans un agenda institutionnel, mais une remise en question profonde de nos manières de faire de la science. Il s’agit de construire un système fondé sur l’entraide, la bienveillance et la flexibilité — non pas malgré le handicap, mais avec lui. Car la recherche et la quête du savoir n’avancent véritablement que dans un climat d’interdépendance, où la pensée autre et la différence ne sont pas seulement tolérées, mais reconnues comme des forces essentielles de transformation et de découverte.