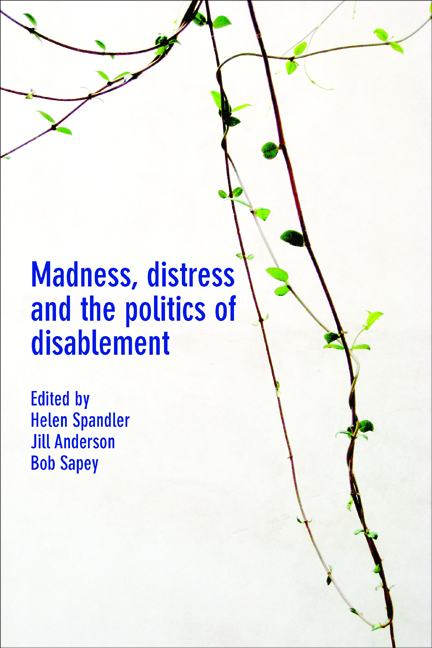Par Steve Graby (2015).
Steve Graby est autiste, agenre, anarchiste et communiste, activiste au sein du mouvement des personnes handicapées et titulaire d’un doctorat à l’Université de Leeds, portant sur l”Assistance Personnelle : le défi de l’autonomie”
Introduction
Ce chapitre retrace les origines et l’évolution du mouvement de la neurodiversité, qui regroupe des personnes ayant des conditions (telles que les troubles du spectre autistique, le TDAH, la dyspraxie ou la dyslexie) positionnées quelque part entre les catégories traditionnelles du « handicap » et de « maladie mentale ».
Le mouvement de la neurodiversité trouve ses racines dans le mouvement des personnes handicapées et celui des survivants de la psychiatrie et, comme on le verra, il a de nouvelles idées à leur offrir. [1]. Il devrait donc intéresser ceux qui cherchent à combler les fossés conceptuels entre les mouvements de personnes handicapées et les mouvements de survivants – tels que le point d’achoppement du concept de « déficience » (Plumb, 1994).
Les écrivains et les activistes du mouvement de la neurodiversité sont parfaitement au fait de la construction sociale de la « souffrance psychique » et du « handicap », et ont développé leur propre analyse de ces concepts.
Ce chapitre donne un aperçu de certaines de ces réflexions. Il s’appuie sur ma propre expérience au sein du mouvement de la neurodiversité. ainsi que sur la littérature publiée par les trois mouvements, pour illustrer les convergences et les divergences entre eux, et propose enfin quelques suggestions pour aller de l’avant.
Les personnes handicapées et les survivants du système psychiatrique : deux mouvements
La relation entre le mouvement des personnes handicapées et le mouvement des survivants est complexe. À ses débuts, le mouvement moderne des personnes handicapées était essentiellement axé sur la déficience physique.
Cela se reflète dans les noms des groupes fondateurs tels que l’Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS), dont la déclaration de principe fondatrice classait les « personnes appelées malades mentales » parmi les « autres groupes opprimés » avec lesquels on estimait que les handicapés physiques devaient s’allier, tout en conservant une identité distincte (UPIAS, 1974).
La « grande idée » du mouvement était le modèle social du handicap (Hasler, 1993). Toutefois, au fur et à mesure qu’une compréhension plus large de ce modèle se développait, les survivants étaient de plus en plus considérés comme faisant partie du mouvement et de la catégorie des « personnes handicapées ».
Ce groupe comprenait d’autres groupes de personnes souffrant de handicaps « non physiques », tels que les sourds et les personnes ayant des difficultés d’apprentissage, groupes qui sont également restés quelque peu séparés, dans leur auto-organisation, du mouvement « plus large » des personnes handicapées.
Les réactions du mouvement des survivants de la psychiatrie ont été mitigées. Certains d’entre eux ont accueilli favorablement le modèle social en raison de son l’attribution du handicap à l’exclusion sociale et à l’oppression, plutôt qu’à quelque chose d’inhérent aux individus.
Pour beaucoup, cependant, le concept de la déficience, distincte du handicap, a été une pierre d’achoppement majeure.
Certains activistes survivants de la psychiatrie affirment que classer la souffrance psychique comme une déficience revient à revenir aux modèles médicaux et pathologiques de la « maladie mentale » auxquels leur mouvement cherche à échapper (Plumb, 1994 ; Wilson et Beresford, 2002).
D’autres activistes survivants, comme McNamara (1996), considèrent le « débat sur la déficience » comme une source préjudiciable au mouvement, arguant que les survivants de la psychiatrie sont « handicapés » par la stigmatisation et l’oppression matérielle qu’ils subissent, qu’ils soient ou non considérés comme ayant une “déficience”.
Cependant, cela soulève toutefois la question des limites du terme « handicap » : comme le souligne Plumb (1994), si le handicap est défini uniquement comme une oppression et que la déficience n’est pas considérée comme une condition préalable à celle-ci, de nombreux autres groupes marginalisés pourraient être considérés comme « handicapés » alors qu’ils ne seraient pas habituellement définis comme tels. [2]
La Neurodiversité : une nouvelle perspective sur le débat
Un développement plus récent pourrait constituer une nouvelle intervention significative dans ce débat : le mouvement de la neurodiversité. Ce mouvement englobe des personnes présentant divers diagnostics (tels que les troubles du spectre autistique, la dyslexie, la dyspraxie et le TDAH), et on peut dire qu’il trouve ses racines à la fois dans le mouvement des personnes handicapées et dans celui des survivants de la psychiatrie.
Le mouvement en faveur de la neurodiversité est né principalement de l’auto-représentation (self-advocacy) des personnes autistes, qui a commencé à émerger dans les années 1990 en réponse à la croissance d’un lobby de « défense de l’autisme » dominé par les parents.
En réponse à la recherche d’un « remède » à l’autisme par ces derniers, les activistes autistes ont soutenu que l’autisme et les troubles similaires devaient être considérés non pas comme des pathologies nécessitant un « remède », mais comme des différences naturelles qu’il convient d’accepter et de prendre en compte.
Il est important de noter que les catégories de diagnostic généralement regroupées sous le terme de la « neurodiversité » se situent quelque peu entre les catégories plus larges de « maladie mentale » et de « handicap/déficience ».
Comme les premières, ces catégories de diagnostic sont incluses dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) et sont principalement diagnostiquées par des psychologues et/ou des psychiatres. Cependant, elles sont également liées aux secondes, d’une part, en raison de leur chevauchement avec les catégories « difficultés d’apprentissage »/ »troubles de l’apprentissage » / “déficience intellectuelle“ et d’autre part parce qu’elles sont généralement définis comme congénitales et permanentes.
Ceci contraste avec la plupart des catégories de « maladies mentales » qui sont généralement considérées comme apparaissant pour la première fois à l’adolescence ou à l’âge adulte, souvent causées par des événements traumatisants de la vie, et épisodiques et/ou « guérissables ».
Le terme « neurodiversité » a commencé à être utilisé vers la fin des années 1990, principalement par la nouvelle génération d’adultes autistes écrivant des récits à la première personne sur leur expérience.
Il est possible qu’il ait eu plus d’une origine indépendante à peu près à la même époque (Meyerding, 2002). L’un des « premiers usages publiés » souvent cités est le chapitre de Judy Singer dans l’ouvrage Disability Discourse, publié en 1999 sous la direction de Marian Corker et Sally French.
Des versions préliminaires de ce chapitre ont circulé parmi les groupes d’autistes en ligne avant sa publication, ce qui a conduit à des usages en ligne du mot antérieurs à l’ouvrage et a généré d’autres usages qui peuvent être attribués à Singer (1999), malgré des dates de publication antérieures (Savarese et Savarese, 2010).
En outre, les perspectives de la neurodiversité ont été formulées par des activistes autistes, tels que Jim Sinclair, Larry Arnold et Martijn Dekker, avant que le mot lui-même ne soit utilisé.
L’article de Sinclair « Don’t mourn for us » (1993) [3], par exemple, bien qu’il n’utilise pas le terme « neurodiversité », est souvent considéré comme l’un des documents fondateurs du mouvement pour la neurodiversité (Boundy, 2008 ; Sinclair, 2012a)
Si les personnes diagnostiquées sur le spectre autistique ont certainement été les principaux initiateurs du terme et du concept – et le mouvement de la neurodiversité reste centré sur l’autisme, beaucoup le considérant comme synonyme du « mouvement pour les droits des autistes » – d’autres troubles telles que le TDAH, la dyslexie, la dyspraxie et, dans certains cas, le domaine plus large des « troubles du développement » ou des « difficultés d’apprentissage » ont été reconnues comme faisant partie de la neurodiversité dès le début.
La représentation des personnes ayant reçu de tels diagnostics dans le mouvement de la neurodiversité a augmenté ces dernières années. En outre, certaines personnes commencent à s’identifier au concept de neurodiversité alors qu’elles ont été classées par la psychiatrie dans des catégories plus communément associées à la « santé mentale » qu’au « handicap » (telles que la « schizophrénie » et le « trouble bipolaire »).
Par exemple, Suzanne Antonetta, qui a été diagnostiquée comme souffrant d’un « trouble bipolaire », a donné son livre de 2005, A Mind Apart – qui décrit son expérience et celle de l’auteure autiste Dawn Prince-Hughes, auteure autiste, ainsi que celles d’amis ayant reçu un diagnostic de diagnostics tels que le « trouble dissociatif de l’identité » (anciennement connu sous le nom de « trouble de la personnalité multiple ») – le sous-titre « Travels in a Neurodiverse World ». Il existe également une communauté en ligne de personnes qui se définissent elles-mêmes comme des « multiples », qui considèrent leurs « personnalités » distinctes non pas comme une pathologie dissociative mais comme des « personnes » différentes partageant un cerveau et un corps, chacune d’entre elles ayant le droit d’exister. Cela a des liens et des recoupements avec les communautés autistes et plus largement neurodivergentes (Baggs, 2006).
L’un des principes fondamentaux de la neurodiversité est que les troubles mentaux tels que l’autisme, le TDAH etc. sont « réelles » et de nature neurologique.
Cela contraste avec l’opinion de nombreux membres des communautés de l' »antipsychiatrie » et de la « psychiatrie critique » selon laquelle le TDAH est une catégorie créée par l’industrie pharmaceutique pour pathologiser le comportement d’enfants qui étaient auparavant simplement considérés comme « mal éduqués », afin de promouvoir la vente de médicaments tels que la Ritaline (voir, par exemple, Timimi, 2002).
De même, le mouvement de la neurodiversité s’oppose à la croyance de nombreux « parents d’enfants autistes » et praticiens de la médecine « alternative » selon laquelle l’autisme est une « épidémie » causée par un certain nombre de facteurs tels que l’alimentation, les polluants environnementaux ou, plus notoirement, les vaccinations telles que celle contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (Waltz, 2013).
Ces conditions sont considérées comme constituant une variété de « neurotypes » minoritaires d’une légitimité égale à celle du neurotype humain majoritaire (dit « normal »), qui ne doivent être ni pathologisés ni « soignés ».
En fait, si les neurotypes minoritaires ne sont pas des « maladies », il ne peut y avoir, par définition, de « remède » pour eux.
C’est pourquoi l’activisme le plus visible du mouvement a consisté à s’opposer à des organisations caritatives telles qu’Autism Speaks, dont les objectifs sont de « guérir » ou d’éliminer l’autisme.
Aux côtés d’organismes publics tels que le New York University Child Study Center, les campagnes publicitaires de ces organisations caritatives présentent l’autisme (et, dans ce dernier cas, d’autres diagnostics psychiatriques) comme une entité monstrueuse et malfaisante, nécessitant une « guerre » métaphorique pour la « vaincre » (Kras, 2010 ; Gross, 2012 ; Sequenzia, 2012).
Cela correspond à l’image des personnes handicapées véhiculée par les associations caritatives telles que l’activisme du mouvement des personnes handicapées à l’encontre d’organisations caritatives telles que Leonard Cheshire au Royaume-Uni et le Téléthon de la Muscular Dystrophy Association aux États-Unis (Johnson, 1994 ; Clark, 2003 ; Withers, 2012).
Les militants de la neurodiversité recherchent donc l’acceptation sociale et l’égalité des chances pour tous les individus, quelle que soit leur neurologie (Ventura33, 2005), estimant que la diversité neurologique doit être célébrée et appréciée, et qu’il n’existe pas un seul type de neurologie qui soit « la meilleure et la seule voie » (AS-IF, 2007).
Les personnes qui rencontrent des difficultés dans la société en raison de leurs différences cognitives ou comportementales par rapport à la norme doivent donc être reconnues et prises en compte, l’accent étant mis sur la nécessité de changer la société plutôt que l’individu [4].
Boundy (2008, non disponible) considère « le désir d’être libéré d’une conformité comportementale forcée » comme la » préoccupation la plus centrale du mouvement et de la communauté de la neurodiversité ».
Le mouvement de la neurodiversité, comme le mouvement des personnes handicapées (Oliver, 1994), est donc très critique à l’égard des paradigmes de paradigmes de « normalisation » et donne la priorité au « bien-être subjectif » (tel que défini par l’individu) plutôt que de fonctionner de manière normative (Kapp et al, 2013).
La neurodiversité est souvent décrite comme comparable à la diversité ethnique et à la diversité des identités sexuelles et de genre (Antonetta, 2005 ; AS-IF, 2007).
Comme l’écrit Nick Walker (2012, 156), militant-e de la neurodiversité, il n’y a pas d’état « normal » du cerveau ou de l’esprit humain, pas plus qu’il n’y a de race, d’ethnie, de sexe ou de culture « normales ».
Le terme « neurotypique » a donc été inventé par les activistes de la neurodiversité pour désigner le neurotype majoritaire sans renforcer son statut privilégié et la marginalisation des autres (Singer, 1999 ; Walker, 2012) [5].
Si un groupe ou une société peut être « neurodiverse », il est généralement généralement considéré comme inexact de qualifier une personne de « neurodiverse », car la neurodiversité englobe à la fois le typique et l’atypique ; cependant, neurodivergent » peut être utilisé comme adjectif générique pour désigner les personnes de neurotypes minoritaires.
D’aucuns ont affirmé que le mouvement de la neurodiversité était influencé par le mouvement des personnes handicapées et enraciné dans celui-ci et, en termes de construction identitaire, par le mouvement de l’identité sourde (voir, par exemple, Dekker, 2004).
D’autres ont également affirmé qu’il était enraciné dans le mouvement des survivants de la psychiatrie et dans les idées qui lui sont associées, comme l' »antipsychiatrie » d’auteurs psychiatres critiques tels que RD Laing et Thomas Szasz (Boundy, 2008) [6].
Pour ceux qui souhaitent combler les fossés conceptuels entre le mouvement des personnes handicapées et celui des survivants, comme par exemple la question de savoir si le concept de « déficience » s’applique aux survivants, le mouvement de la neurodiversité devrait donc présenter un grand intérêt en tant que fusion déjà existante de ces deux mouvements.
Les activistes du mouvement de la neurodiversité cherchent à récupérer les étiquettes de trouble (comme l’autisme) de l’autorité des professions médicales et psychologiques, et à les revaloriser, en termes positifs, en tant que composantes d’une identité autodéterminée (Sinclair, 2012b ; Meyerding, 2002).
En cela, le mouvement de la neurodiversité adopte une position similaire au « modèle d’affirmation du handicap proposé par Swain et French (2000) et développé par Cameron (2008 ; 2011).
Ce dernier soutient qu’un modèle affirmatif de l’identité « handicapée », cohérent et complémentaire du modèle social, affirmant non pas le handicap mais la déficience. La déficience, à son tour, est redéfinie comme « une différence qui doit être reconnue et respectée en tant que telle dans une société diverse » (Cameron, 2008, 24).
Cette position est associée à des slogans de mouvement tels que « célébrer la différence avec fierté » et est étroitement liée à la position « Mad Pride » de certains courants radicaux au sein du mouvement des survivants de la psychiatrie (par exemple, Curtis et al, 2000).
Le modèle d’affirmation du handicap permet de comprendre le handicap en tant qu’oppression politique, sans nécessairement attribuer une valeur négative aux différences physiques ou mentales traditionnellement qualifiées de « déficiences ».
Cela signifie que l’avertissement de Plumb (1994) selon lequel « admettre une déficience » signifie « légitimer et maintenir le lien avec la « maladie » » (p. 18) n’est pas nécessairement vrai.
Le traumatisme, les oppressions systémiques et la problématique de la souffrance psychique
L’expérience de la souffrance psychique est cependant difficile à intégrer dans un modèle d’affirmation positive.
On peut soutenir que, par définition, le terme « souffrance psychique » ne peut décrire que quelque chose de mauvais et d’indésirable.
C’est pourquoi de nombreux survivants de la psychiatrie ne s’identifient pas au concept de « Mad Pride » et il existe des tensions considérables au sein du mouvement des survivants entre, d’une part, ceux qui considèrent leur « folie » comme positive ou neutre et, d’autre part, ceux qui considèrent la « souffrance psychique » comme un problème nécessitant une solution, même si celle-ci n’est pas d’ordre médical ou psychiatrique.
Il pourrait être facile de rejeter la perspective de la neurodiversité comme n’étant pas du tout utile à ce dernier groupe, qui peut considérer que ses expériences de souffrance psychique sont enracinées dans le traumatisme, l’oppression systémique et les exigences impossibles de la vie dans une société profondément aliénante, plutôt que dans une quelconque « différence » à laquelle une valeur positive pourrait être attribuée.
Toutefois, les auteur-trice-s et les militant-e-s du mouvement de la neurodiversité sont parfaitement conscients des problèmes liés à la souffrance psychique et s’en préoccupent. Ils ont développé une analyse considérable de cette souffrance psychique, dans un cadre qui la distingue clairement de la « différence » (qui ne pose pas de problème).
Les militants de la neurodiversité tiennent également à souligner que de nombreuses personnes ayant un TDAH ou l’autisme dit de « de haut niveau » ne sont pas diagnostiquées à l’âge adulte – en particulier si leur comportement ne correspond pas aux stéréotypes des psychiatres concernant ces troubles – et que cette expérience entraîne très souvent une détresse mentale et/ou un recours au système de « santé mentale ».
Il peut s’agir d’un mauvais diagnostic, avec des étiquettes telles que « schizophrénie », qui comporte également des aspects sexospécifiques, les femmes étant sans doute plus susceptibles que les hommes d’être mal diagnostiquées ou de ne pas être diagnostiquées (Baker, 2004).
Les militants de la neurodiversité soutiennent cependant que la souffrance ressentie par ces personnes n’est généralement pas due à leur neurotype réel, mais plutôt à une réaction (tout à fait raisonnable) au fait d’être continuellement incompris et rejeté par une société normative neurotypique ; un exemple de ce que Thomas (1999) décrit comme le capacitisme psycho-émotionnel (voir Reeve, 2012a ; et aussi, Donna Reeve, chapitre 7, dans ce volume).
Ainsi, ce qui est nécessaire pour soulager la souffrance psychique n’est pas une intervention « médicale », mais une transformation de la société. Cette position correspond bien à la conceptualisation de Plumb (1994) de la souffrance psychique comme « dissidence », ainsi qu’à l’affirmation centrale du modèle social du handicap : une société invalidante, plutôt qu’un individu handicapé, est « le problème ».
Par une ironie vicieuse, cette souffrance psychique peut alors elle-même être considérée comme une « pathologie » par la société, ce qui entraîne l’implication du système psychiatrique, où elle est encore plus pathologisée dans le cadre d’un paradigme de « maladie » axé sur les « symptômes ». En effet, certains activistes de la neurodiversité suggèrent que bon nombre des caractéristiques actuellement considérées comme répondant aux critères de diagnostic de maladies telles que l’autisme sont – plutôt que des marqueurs de différences « innées » – les effets traumatiques d’une oppression capacitiste psycho-émotionnelle permanente subie par les personnes neurodivergentes.
Ces réactions sont encore plus susceptibles d’être pathologisées si cette différence « innée » entraîne des réactions au traumatisme qui sont suffisamment différentes de celles des personnes neurotypiques pour ne pas être facilement reconnues comme telles – et considérées plutôt comme un comportement « inintelligible » (Pilgrim et Tomasini, 2012) – et/ou si des situations sont vécues comme traumatisantes alors qu’une personne neurotypique ne les reconnaîtrait probablement pas comme telles ; par exemple, une personne autiste hypersensible au bruit peut trouver le bruit de la foule ou de la circulation insupportable et pourrait donc y réagir de la même manière qu’à une douleur physique, c’est-à-dire en pleurant ou en criant, en fuyant le bruit dans une apparente panique, ou en faisant des mouvements répétitifs (comme battre des mains ou se frapper la tête) comme un contre-stimulus pour y faire face.
Du point de vue de la neurodiversité, le concept de « maladie mentale » peut donc être considéré comme une catégorie socialement construite incluant à la fois la « neurodivergence pathologisée » et la souffrance psychique résultant d’un handicap psycho-émotionnel ou d’autres formes d’oppression.
Les partisans de la neurodiversité auraient tendance à accepter que certains aspects de certains neurotypes divergents puissent être pénibles (par exemple, les intolérances sensorielles et/ou les difficultés de traitement auditif que connaissent de nombreux autistes, ou la difficulté à suivre une conversation qu’éprouve une personne ayant un TDAH) [7].
Ils se demandent toutefois si ces différences sont « intrinsèquement » pénibles ou s’il s’agit plutôt d’un environnement social et environnemental qui n’est pas adapté à l’individu. La plupart accepteraient également la possibilité que, pour certaines personnes (mais certainement pas toutes) qui éprouvent une souffrance mentale, cette souffrance puisse être causée par une forme de facteur physique ou chimique, et donc ne pas provenir de conditions sociales ou environnementales, bien qu’elle puisse être exacerbée par ces dernières.
Dans de tels cas, cependant, l’auto-définition et l’autodétermination, plutôt que l’autorité médicale paternaliste, seraient toujours considérées comme la base préférée de toute réponse sociale à la souffrance psychique.
Par conséquent, le cadre de la neurodiversité peut permettre d’inclure à la fois ceux qui identifient leur souffrance psychique comme étant purement biochimique et ceux qui la considèrent comme étant purement « socialement réactive ». Il n’est pas nécessairement mutuellement exclusif de conceptualiser la souffrance psychique à la fois comme faisant partie de certaines « déficiences » et comme le résultat de conditions sociales injustes et oppressives.
Les activistes de la neurodiversité ont tendance à accepter qu’un changement social à grande échelle est un objectif trop ambitieux et à long terme pour être utile à un individu en souffrance aiguë, quelle qu’en soit l’origine.
Ils soutiennent donc généralement une réponse pragmatique et libertaire à la détresse individuelle, basée sur le « traitement » qu’un individu donné juge utile pour lui. Par exemple, si les militants de la neurodiversité s’opposent à la prescription systématique de médicaments psychotropes à des fins de « normalisation » (comme les stimulants tels que la Ritaline pour le TDAH) et à l’administration de médicaments sans consentement (soit directement contre la volonté du « patient », soit à des enfants trop jeunes pour donner un consentement éclairé), la plupart d’entre eux soutiendraient le droit de l’individu de choisir de prendre de tels médicaments, s’il en trouve les effets utiles.
Cette position s’accorde bien avec les idées soutenues par le mouvement des survivants de la psychiatrie, comme le « modèle centré sur le médicament » de l’action des drogues psychoactives, qui a été proposé par la psychiatre critique Joanna Moncrieff (2007) pour remplacer le « modèle centré sur la maladie » de la psychiatrie biomédicale dominante.
En conceptualisant les médicaments en fonction des effets actifs qu’ils produisent et de leur utilité, plutôt que comme le « remède » ou le « traitement » d’une « maladie », le modèle de Moncrieff permet aux personnes en souffrance psychique de prendre leurs propres décisions quant à l’utilisation ou non de médicaments (ou d’autres « traitements »).
Convergences et divergences
L’idée du mouvement de la neurodiversité d’un spectre de neurotypes également valides, méritant d’être reconnus et acceptés, plutôt que d’être pathologisés, est reprise par certains auteurs du mouvement des survivants de la psychiatrie. Par exemple, la survivante féministe américaine Kate Millett, auteure de The Loony Bin Trip, un récit autobiographique de son expérience de traitement coercitif dans les systèmes de santé mentale américain et irlandais, a écrit :
“Que le sain soit compris comme un spectre qui va de l’équilibre d’une part à la fantaisie d’autre part. Peut-être aussi les mathématiques supérieures. À une extrémité, le travail quotidien mais exigeant de l’esprit, à l’autre, le surréalisme, l’imagination, la spéculation… Un spectre. Un arc-en-ciel. Tous humains. Tous bons ou au moins moralement indifférents. Des lieux dans le grand pays encore inexploré de l’esprit. Aucun n’est interdit. Aucun à punir. Aucun à craindre. Si nous devenons fols, et alors ? Nous reviendrons si nous ne sommes pas chassés, exilés, isolés, confinés. (Millett, 1990, 314)
On pourrait y voir une « préfiguration » du concept de neurodiversité, près d’une décennie avant qu’il ne soit inventé. Cependant, une différence significative subsiste.
Alors que les militants de la neurodiversité insistent sur le fait que leurs « différences » sont permanentes et de nature biologique, de nombreux survivants du système de santé mentale rejettent fermement l’idée qu’il existe une différence neurologique fondamentale entre eux et d’autres personnes (« normales »/« typiques » ou non étiquetées psychiatriquement) ; ils affirment plutôt qu’ils ont des réactions « naturelles » aux expériences traumatisantes et/ou oppressives qu’ils ont vécues.
Plumb (1994), par exemple, cite une analogie utilisée par le survivant activiste, Mike Lawson, qui a estimé que l’état mental pathologisé sous le nom de « schizophrénie paranoïaque » ressemblait à un hérisson qui se met en boule en réponse à un danger ; il s’agit pourtant d’une analogie à laquelle de nombreuses personnes autistes qui font l’expérience du «shutdown » en réponse au stress, y compris moi-même, peuvent tout à fait s’identifier !
Cette différence de perspective peut s’expliquer en partie par les expériences particulières des personnes classées dans différentes catégories de diagnostic.
De nombreuses personnes autistes, par exemple, ont beaucoup souffert de l’idée qu’elles-mêmes ou leur famille sont « à blâmer » pour leurs différences et/ou leurs difficultés, ou qu’il doit y avoir une cause traumatique qui doit être « découverte » et « traitée » par une thérapie psychanalytique ou d’autres formes de « thérapie par la parole », visant à « guérir » ce « dommage » qui n’existe pas [8].
Pour certaines personnes, ce peut être un énorme soulagement de découvrir que leur divergence par rapport à la norme sociale est due à une différence neurologique innée ; qu’elles ne sont pas une personne autrefois « normale » qui a été «cassée», mais qu’elles étaient un type de personne différent – et tout aussi « entier » – dès le départ.
À l’inverse, de nombreux survivants du système de santé mentale associent les idées de différence biologique à des modèles médicaux et à des « traitements » fondés sur la biologie, tels que les médicaments psychotropes, qui les ont souvent profondément opprimés et violentés (des violences dont le mouvement de la neurodiversité est également très conscient, il convient de le souligner).
De nombreux survivants de la psychiatrie n’ont jamais vu leur environnement social considéré comme la « cause » de leur souffrance psychique, l’étiquette de « maladie mentale » étant utilisée pour nier la réalité de leur expérience de la violence et de l’oppression.
Alors que certains membres du mouvement des survivants de la psychiatrie considèrent la psychanalyse ou d’autres « thérapies par la parole » comme des réponses beaucoup plus positives aux « problèmes de la vie », les militants autistes – tels que Judy Singer (1999) et Mel Baggs (2006) [9] – critiquent souvent vivement ces paradigmes, qu’ils considèrent comme des réponses inutiles et inadaptées à leurs besoins.
Cette critique est en partie due au paradigme de la « culpabilisation des parents » mentionné ci-dessus – partagé par certains auteurs de l’« antipsychiatrie », comme Alice Miller (1991) et Peter Breggin (1994) – mais elle est aussi en partie due à des problèmes fondamentaux liés à la relation de pouvoir paternaliste et inégale entre le thérapeute et le patient.
De même, les perspectives suspicieuses sur les « thérapies par la parole » sont partagées par d’autres courants du mouvement des survivants de la psychiatrie, tels que les groupes de survivants des psychothérapies.
Les expériences et les points de vue des membres du mouvement des survivants de la psychiatrie et le mouvement de la neurodiversité peuvent sembler opposés l’un à l’autre.
Cependant, tous deux résultent d’une incompréhension et d’un mauvais traitement de la part d’un système psychiatrique oppressif paternaliste, qui part du principe qu’il connaît et comprend l’esprit, les expériences et les besoins de ses « patients » mieux qu’eux-mêmes, et qui se concentre sur la « guérison » ou la « normalisation » de la personne, plutôt que sur la transformation de la société dans laquelle vit la personne en une société dans laquelle elle peut être heureuse et acceptée.
Certaines personnes peuvent trouver les médicaments psychotropes nocifs et les thérapies par la parole utiles ; d’autres trouveront les thérapies par la parole nocives et les médicaments utiles ; d’autres encore peuvent trouver les deux aussi nocifs l’un que l’autre et préfèrent qu’on les laisse simplement « tranquilles ».
Cependant, indépendamment de ces choix individuels, les questions les plus importantes sont l’autodétermination quant au « traitement » ou à l’« assistance » (s’il y en a un) qui convient aux besoins individuels, et la compréhension de la différence, de la souffrance et de la dissension comme étant toutes situées dans des contextes sociaux et politiques (plutôt que d’être simplement des « pathologies » de l’individu).
Si cette autodétermination et cette compréhension étaient disponibles pour tous, la question de savoir si l’origine de la différence sociale ou émotionnelle d’une personne est « traumatique » ou « congénitale » – bien qu’elle puisse « compter » profondément pour l’individu en termes de perception et de compréhension de soi – ne « compterait » pas nécessairement pour la société en termes de manière dont cette personne devrait être « traitée » ou recevoir une réponse.
Dans tous les cas, la compréhension qu’a la personne de ses besoins serait acceptée et ses besoins pris en compte.
Conclusions
Je pense que les idées du mouvement de la neurodiversité peuvent fournir un « pont » utile pour surmonter certaines des divergences conceptuelles et pratiques entre le mouvement des personnes handicapées et le mouvement des survivants de la psychiatrie.
Certains membres des deux anciens mouvements peuvent être en désaccord – entre eux et avec le mouvement de la neurodiversité – sur certaines des idées et de la terminologie utilisées.
Je pense toutefois que les idées issues de la neurodiversité peuvent enrichir les perspectives des deux mouvements de manière à mettre en lumière les points communs qu’ils partagent. C’est particulièrement le cas si l’on aborde la question en reconnaissant que tous les termes et définitions sont imparfaits et peuvent être contestés.
Je pense que les militants du mouvement de la neurodiversité, en raison de leurs identités et de leurs expériences qui se recoupent avec les mouvements des personnes handicapées et des survivants, ont un rôle important à jouer dans l’élargissement des possibilités de dialogue et de collaboration entre eux.
Le fait que les personnes et les expériences impliquées dans tous ces mouvements se recoupent nous rappelle également que les catégories telles que « handicapé » et « survivant » n’ont pas nécessairement de frontières strictes et définissables.
Toutefois, cela ne signifie pas que ces catégories ne sont pas « réelles » ou importantes en termes de théorisation et de lutte active contre l’inégalité et l’oppression.
Je suggère que le mouvement de la neurodiversité est particulièrement bien placé pour rassembler des catégories plus larges de personnes marginalisées dans un réseau de solidarité (nécessairement large, mais néanmoins potentiellement extrêmement important) de mouvements luttant pour l’acceptation radicale de tous les types de diversité humaine, sous une large bannière d’« anti-normalisation » (Bumiller, 2008) et de résistance aux supposées hypothèses « universelles » sur la « nature humaine » qui privilégient les groupes majoritaires et historiquement dominants.
Dans le climat politique et économique actuel, dans lequel les réductions de la protection sociale motivées par l’idéologie néolibérale menacent la survie même des personnes handicapées ou autrement défavorisées au Royaume-Uni et dans de nombreuses autres sociétés « occidentales », et dans lequel la ségrégation des « pauvres » en catégories distinctes est utilisée par les gouvernements et les médias pour « diviser pour régner » et empêcher une opposition efficace, une telle mise en réseau et une telle collaboration sont plus que jamais nécessaires.
Les expériences des personnes classées dans différentes catégories ou qui s’identifient à différents mouvements sont nécessairement différentes et leurs différences ne doivent pas être effacées au nom de l’unité ; cependant, elles ne doivent pas non plus être essentialisées d’une manière qui conduise à un séparatisme qui divise.
Un principe fondamental du mouvement de la neurodiversité est que les personnes et leurs points de vue peuvent être radicalement différents les uns des autres, mais que tous peuvent faire partie d’une société inclusive qui reconnaît la réalité – parfois difficile, mais souvent positive – de ces différences, sans les stigmatiser ni les pathologiser.
Ce respect réaliste mais anti-essentialiste de la différence et de la diversité peut, je crois, être la base d’un travail commun pour notre libération à tous et toutes.
Notes
- Il existe un grand nombre de termes différents utilisés pour désigner le mouvement social des personnes psychiatrisé-e-s étiquetées comme souffrant de « maladie mentale » qui, comme le souligne Peter Beresford (2004), sont tous opposés ou considérés comme offensants par certaines sections du mouvement. J’ai décidé de manière quelque peu arbitraire d’utiliser le terme « mouvement des survivants » dans le présent document, principalement par souci de simplicité – je présente mes excuses à ceux qui préfèrent d’autres termes.
- Il convient de noter ici qu’il existe un certain désaccord au sein du mouvement des personnes handicapées sur le sujet de la déficience, certains auteurs handicapés, en particulier féministes et post-structuralistes, soutenant que la distinction entre déficience et handicap n’est pas aussi nette qu’il n’y paraît dans les lectures simplistes du modèle social, compte tenu notamment du fait que la déficience elle-même peut être considérée comme socialement construite (voir, par exemple, Thomas, 1999 ; Thomas et Corker, 2002 ; Tremain, 2002).
- Article de Sinclair’s “Ne vous lamentez pas pour nous” – “ Don’t Mourn for us” a été originellement publié en 1993 dans la Newsletter de Autism Network International, Our Voice, Volume 1, Number 3, www.autreat.com/dont_mourn.html
- Il s’agit bien entendu d’un élément essentiel du modèle social du handicap.
- Ceci est parallèle à l’utilisation de termes tels que « cisgenre » par opposition à « transgenre » dans la communauté LGBT. Bien qu’il n’entre pas dans le cadre de ce chapitre, le mouvement de libération et de défense des droits des LGBT et/ou des « queers » se préoccupe également de l’acceptation des identités en tant que composantes valables de la diversité humaine, qui étaient auparavant pathologisées en tant que « troubles mentaux ». En tant que tel, il présente d’importants recoupements avec le mouvement de la neurodiversité (voir, par exemple, Lawson, 2005 ; Bumiller, 2008).
- Il convient toutefois de noter que si certaines parties du mouvement des survivants, en particulier en Amérique du Nord, ont certainement été inspirées par l’antipsychiatrie, le corpus théorique antipsychiatrique a été principalement développé par des universitaires et des membres dissidents des professions « psy », plutôt que par les survivants eux-mêmes. Il ne peut donc pas être considéré comme la théorie du mouvement des survivants.
- Dans le cadre du modèle social du handicap, il s’agirait d’exemples de ce que Thomas (1999, 42-3) appelle les « effets de la déficience » (par opposition au handicap, y compris la déficience psycho-émotionnelle).
- La théorie la plus connue, et sans doute la plus influente, dans le domaine de l’autisme est celle du psychologue pour enfants du milieu du XXe siècle, Bruno Bettelheim, qui soutenait que l’autisme était causé par des « mères frigidaires » émotionnellement négligentes (Waltz, 2013). Si, dans le monde anglophone, ses théories ont été largement supplantées par les paradigmes biomédicaux, on peut dire qu’elles restent dominantes dans d’autres pays, comme la France (Jolly et Novak, 2012).
- L’écrivain et activiste autiste Mel Baggs a précédemment écrit sous les noms d’Amanda ou AM Baggs, noms sous lesquels elle est sans doute encore plus connue (en particulier pour ses écrits sur le site web autistics.org et sa vidéo « In My Language ».
Source : https://www.cambridge.org/core/books/abs/madness-distress-and-the-politics-of-disablement/neurodiversity-bridging-the-gap-between-the-disabled-peoples-movement-and-the-mental-health-system-survivors-movement/DD17D4672892ED8BDA06FE2A97E84049 publiée en 2015 dans Madness, Distress and the politics of disablement.
Traduction de l’anglais. Si vous avez des suggestions d’amélioration. Merci de nous contacter.
Description de l’image : Couverture du livre Madness, Distress and the politics of disablement. Edited by Helen Splander, Jill Anderson, Bob Sapey. Des tiges de plantes vertes illustrent la couverture.
Crédit image : Bristol University Press